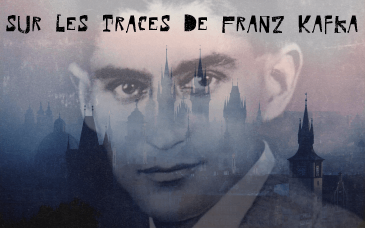Ecole de Paris : trois artistes tchèques oubliés exposés au Manège Wallenstein à Prague
Quand on pense au Paris artistique de l’entre-deux-guerres et aux artistes tchécoslovaques qui y ont séjourné et créé, les noms de František Kupka, Josef Šíma ou Toyen viennent immédiatement à l’esprit. Pourtant, à l’époque, ces artistes avant-gardistes étaient beaucoup moins connus que trois autres de leurs compatriotes : Jiří – George – Kars František – François – Zdeněk Eberl et Otakar Kubín/Othon Coubine. Pourtant, avec le temps, leur notoriété s’est inversée : jusqu’au 2 mars 2025, une exposition au Manège Wallenstein à Prague les remet à l’honneur.
Anna Pravdová, bonjour, vous êtes une invitée régulière de notre antenne pour parler d’art, des artistes tchèques en France, puisque cela représente votre sujet d’étude tout au long de votre carrière en tant qu’historienne de l’art. Vous êtes évidemment conservatrice à la Galerie nationale de Prague. Nous nous retrouvons aujourd’hui pour parler d’une nouvelle exposition de la Galerie nationale qui se trouve au manège Wallenstein, dans le quartier de Malá Strana à Prague, une exposition qui est consacrée à trois artistes tchèques, peut-être moins connus que ceux que l’on connaît d’habitude pour l’entre-deux-guerres. Comment est née cette exposition qui est intitulée École de Paris ?
« C’est important d’ajouter le sous-titre : les artistes tchèques à Paris dans l’entre-deux guerres. Parmi les trois artistes auxquels l’exposition est consacrée, on a des artistes tchécoslovaques de langue tchèque et des artistes tchécoslovaques de langue allemande. »
C’est très important de rappeler cela, puisque la Tchécoslovaquie était alors un pays multiethnique et multilingue.
« Exactement. Je m’intéresse depuis longtemps aux relations artistiques franco-tchèques et je me suis concentrée tout d’abord sur les artistes les plus connus aujourd’hui, comme František Kupka, Josef Šíma ou Toyen et Štyrský, mais je voulais savoir quelle était la vie quotidienne des artistes tchèques à Paris, comment ils sont parvenus, dans l’entre-deux-guerres à se mêler à ce milieu cosmopolite de Paris. A l’époque où la ville était vraiment le centre mondial de l’art, est-ce qu’ils ont été partie intégrante de ce qu’on appelle l’Ecole de Paris, c’est-à-dire ce milieu cosmopolite d’artistes venus du monde entier à Paris, notamment des pays de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est ? Je me suis rendu compte qu’à l’époque, ce n’était pas Šíma ou Kupka qui étaient les plus connus, mais que c’était František Zdeněk Eberl, Jiří – George – Kars et Othon Coubine qui ont réellement réussi à s’intégrer sur cette scène artistique, ont participé à pratiquement tous les salons, dont les œuvres ont été reproduites dans les comptes-rendus des salons, dans les revues artistiques, qui ont eu des expositions personnelles dans des galeries prestigieuses. À Paris à l’époque, ils ont fait partie de nombreuses expositions collectives, et donc de cette vie quotidienne artistique à Montmartre et à Montparnasse. »
Comment expliquez-vous ce retournement de notre point de vue : aujourd’hui évidemment les grands artistes que vous citez, Josef Šíma, František Kupka ou Toyen, sont ceux que l’on connaît et on connaît moins František Zdeněk Eberl ou George Kars. Comment se fait-il que cette notoriété ait changé ?
« C’est une question assez complexe. Il faut rappeler que Šíma, Kupka, Toyen étaient des artistes qui sortaient des sentiers battus, notamment Kupka qui était le pionnier de l’art abstrait ou Šíma qui était très proche du surréalisme. Toyen aussi, qui a créé avec Štyrský son propre mouvement à Paris. Tout ça, c’étaient des artistes qui expérimentaient, qui cherchaient leur voie/x à l’écart des sentiers battus. Comme souvent, on est un peu ignoré par le large public quand on expérimente, quand on cherche de nouvelles voies. Tandis que Kubin, Kars et Eberl ont fait partie de ce qu’on appelle aujourd’hui le néoclassicisme moderne qui incarne le retour à l’ordre. Après la Première Guerre mondiale, ces artistes, comme André Derain ou Picasso pour un certain temps, se sont retournés vers les valeurs classiques de la peinture. Leur peinture était de très bonne qualité. Et chacun avait quand même, au sein du néoclassicisme, une position assez originale. »
D’où viennent les œuvres qui sont présentées dans le cadre de l’exposition qui dure jusqu’au 2 mars 2025 ? Est-ce qu’elles viennent de collections privées, d’institutions ?
« Elles viennent de tous les horizons possibles. Beaucoup d’institutions publiques, et non seulement tchèques, mais aussi françaises. Je suis très reconnaissante aux musées français de nous avoir fait confiance et de nous avoir fait des nombreux prêts. Il y a le Musée national de Monaco. Mais il y a aussi une grande collection privée de Vienne, une collection privée suisse, et de nombreuses collections privées tchèques. »
Peut-on présenter en quelques mots ces trois artistes que vous exposez ? Qui sont-ils ? Vous disiez tout à l’heure qu’en effet, ce sont des artistes tchécoslovaques, de langues différentes. Certains sont tchécophones, d’autres sont germanophones. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ?
« On peut commencer par Georges Kars, qui a été le premier des trois à s’installer à Paris. Il vivait à Paris dès 1908, après être passé par Munich. A Munich, il a rencontré notamment Jules Pasquin, qui lui a donné envie de venir à Paris et qui l’a présenté à tous ses amis parisiens à l’époque. Donc, Georges Kars a vraiment très vite pu intégrer ce milieu artistique de Montmartre. Quand il s’est marié en 1908 à Paris, son témoin de mariage était Guillaume Apollinaire. Et il a été ami avec Max Jacob. Très vite, il s’est lié d’amitié avec ce qu’on appelle la ‘Trinité maudite’, Suzanne Valadon, André Utter, Maurice Utrillo. Ils passaient leurs étés ensemble, ils se fréquentaient. On a dans l’exposition un très beau portrait de Maurice Utrillo par Georges Kars, qui a également réalisé un dessin de Suzanne Valadon sur son lit de mort. A l’inverse, il y a des œuvres d’Utrillo que ce dernier a réalisées spécialement pour Kars. Mais il faut évoquer aussi une amitié particulière avec Chana Orloff, une artiste d’origine ukrainienne qui s’est installée à Paris et qui a fait beaucoup de portraits de personnalités artistiques, dont notamment un buste de Georges Kars. Grâce aux héritiers de Chana Orloff, on a aussi une belle section consacrée à son travail, à son amitié avec Georges Kars. »
C’est un aspect intéressant de l’exposition : vous mettez en lien ces artistes tchèques avec des personnalités importantes de l’époque. Et si des visiteurs français viennent voir cette exposition, ils peuvent aussi se repérer grâce à cela, même s’ils ne connaissent pas l’artiste tchèque à l’origine…
« Tout à fait. L’exposition présente tout le contexte de l’époque. C’est pour cette raison aussi que l’on a une très belle œuvre de Modigliani, prêtée par le Musée d’art moderne de Paris, mais aussi des œuvres de Soutine, Chagall ou Pasquin. Je reviens à Georges Kars : avant la guerre, il avait une peinture très intéressante, très marquée par le cubisme et le travail de Cézanne. Et chez lui, le ‘retour à l’ordre’ se manifeste vers la fin de la Première Guerre mondiale : il se met à peindre beaucoup de nus, de portraits féminins, mais aussi de paysages. Il disait lui-même qu’il peignait la femme en général, pas une femme concrète. Et je trouve que ses portraits de femmes sont très intéressants et sont devenus un peu l’expression typique de son travail entre les deux guerres. »
Parlons d’Othon Coubine maintenant. On peut rappeler à cette occasion que tous ces artistes ont francisé leur prénom ou leur patronyme. Pour Georges Kars, c’est Jiří en tchèque. Otakar Kubín devient Othon Coubine. Qui est ce peintre ?
« Kubín/Coubine est arrivé en France en 1912. A la différence de Georges Kars, qui est revenu se battre aux côtés de l’Autriche-Hongrie pendant la Première Guerre mondiale, Coubine est resté en France. Là-bas, il a été interné en tant que citoyen de pays ennemi, mais est parvenu à sortir de son camp d’internement et à rejoindre ce qu’on appelle la colonie tchécoslovaque pendant la Première Guerre mondiale. Tous ces gens se battaient pour l’indépendance tchécoslovaque. A la fin de la guerre, il a eu un fils, mais qui est mort quelques mois après sa naissance. Sa femme est également morte peu après. Il s’est retiré en Provence, dans le petit village de Simiane-la-Rotonde. Il a passé pratiquement tous les années 1920 là-bas, mais avait un marchand d’art très actif à Paris, Adolphe Basler, qui a vraiment fait le maximum pour le promouvoir. Un collectionneur en particulier s’est entiché de son travail : le fameux Léo Stein, frère de Gertrude Stein. C’est lui qui a initié Gertrude Stein à collectionner de l’art. Ils ont été les premiers à acheter des Picasso, des Matisse, dès 1905. Mais Léo Stein a ensuite arrêté de collectionner les cubistes et les artistes les plus modernes, il a arrêté de collectionner tout court. Pourtant, dans les années 1920, il a vu un paysage de Coubine au salon des Tuileries et l’a acheté. Finalement, il s’est assuré par un contrat avec Adolphe Basler la moitié de toute la production de Coubine pendant quelques années. Ainsi, il a constitué une belle collection qu’il a ensuite en grande partie envoyée aux États-Unis. Elle n’est revenue en Europe que récemment, parce qu’un collectionneur tchèque l’a découverte là-bas. Elle est donc exposée pour la première fois aujourd’hui en Tchéquie, et donc en Europe. Dans les années 1950, le régime communiste a réussi à promettre à Coubine des choses, qu’il aurait un atelier, une maison, tout ce dont il aurait besoin à sa disposition, et il a accepté de revenir en Tchécoslovaquie. Il est resté dix ans, mais a compris qu’il s’était fait un peu avoir pour être une sorte de vitrine du régime communiste. Il est donc reparti avec sa [seconde] femme et il est mort à Apt. »
Le dernier, c’est François – František – Zdeněk Eberl, peut-être le moins connu de ces trois artistes. C’est vraiment une grande découverte, je pense, pour le public.
« Oui, František Eberl est complètement tombé dans l’oubli, notamment parce qu’il n’est jamais revenu ici. Comme tous ces artistes qui ont vécu à l’étranger, notamment à l’Ouest, jusqu’à la révolution de Velours de 1989, on n’en parlait absolument pas. Georges Kars est resté un peu dans les consciences : il est né à Kralupy nad Vltavou et sa ville natale s’est toujours un peu réclamée de lui. Mais Eberl, pas du tout. Il n’avait pas d’attaches, il est parti très tôt et ne revenait jamais en Tchécoslovaquie : il s’est vraiment intégré à Paris et à ce milieu artistique de Montmartre. Il a fait plusieurs expositions personnelles. Il a d’abord peint des peintures assez typiques de l’Ecole de Paris, les natures mortes, les paysages, beaucoup de chats. Mais au milieu des années 1920, il a trouvé vraiment sa voie dans la peinture : il a commencé à s’intéresser à la pègre parisienne, se rendant dans les bals populaires, et les bals musettes, fréquentant les hôtels de passe. Il a peint des prostituées et des femmes alcooliques. On a une très belle toile prêtée par le musée de Monaco qui s’appelle Coco, qui est un portrait d’une femme dépendante de la cocaïne. Mais il a représenté toutes ces femmes avec beaucoup de fierté, beaucoup de respect. C’est selon moi une position artistique assez originale au sein de l’Ecole de Paris. »
Dans l’exposition, il y a aussi de très belles toiles où il représente des Apaches, et tous ces gens des milieux marginaux de la vie parisienne…
« Il y a en effet plusieurs portraits avec les Apaches, dont notamment un avec la fameuse modèle, Kiki de Montparnasse et son Apache ! »
Peut-on dire que les trajectoires de ces trois artistes reflètent, comme dans le cas de beaucoup d’autres artistes tchèques et slovaques d’ailleurs, l’histoire mouvementée de la Tchécoslovaquie au XXe siècle ? Est-ce que ça, ça se reflète dans leur trajectoire ?
« Complètement. C’est une belle remarque. On a un artiste qui est revenu en pays tchèques en tant que citoyen d’Autriche-Hongrie, puis parce qu’il était d’origine juive, Kars a dû fuir Paris après l’occupation. Il a fui vers le sud, mais quand l’armée allemande est arrivée, il a fui avec Chana Orloff vers la Suisse. Il a réussi à vivre en Suisse presque jusqu’à la fin de la guerre. Malheureusement, le 5 février 1945, épuisé psychiquement et par ce qu’il apprenait de qui était arrivé aux Juifs pendant la guerre, il a sauté de la fenêtre de son hôtel à Genève. »
« A côté de ça, on a Coubine qui est revenu en Tchécoslovaquie après la Deuxième Guerre mondiale, qui a soutenu le régime communiste pendant dix ans, en étant une sorte de vitrine : le régime s’est servi de lui pour dire ‘regardez, il a vécu en France, mais il est mieux ici’.
« Je n’ai pas mentionné Eberl qui était très actif aussi pendant la Première Guerre mondiale : il s’est engagé et a été blessé. Il a quitté le front, mais a été affecté à une ambulance de la Croix-Rouge. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’est un peu engagé dans la Résistance. Plus tard, il a vécu entre Paris et Monaco, mais était très actif aussi comme organisateur d’expositions. C’est vrai, les trois destins reflètent vraiment les différentes facettes de l’histoire tchécoslovaque. »
Comment est-ce qu’un artiste étranger, tchèque issu de cette petite nation que beaucoup découvraient dans l’entre-deux-guerres, pouvait s’intégrer sur cette scène artistique parisienne ? Était-elle ouverte ? Était-elle un peu fermée ? Est-ce que cette scène artistique et intellectuelle captait finalement tout ce qui venait de l’extérieur ?
« Elle était à la fois ouverte et fermée. C’est pour ça, d’ailleurs, que l’École de Paris est née : en 1925, André Warnod a eu besoin d’affirmer que l’École de Paris existait. Il répondait à des critiques un peu xénophobes selon lesquelles il y avait trop d’artistes étrangers dans les salons parisiens : les critiques conservateurs parisiens critiquaient la déformation du bon goût français par les étrangers, etc. C’est lui qui a théorisé cette présence en lui donnant un nom et en affirmant que ça faisait vraiment partie de l’art français, que les étrangers apportaient beaucoup et qu’ils faisaient partie intégrante de l’art français. De toutes façons en comparaison avec d’autres villes, Paris était extrêmement ouverte aux étrangers : on pouvait venir, s’y installer, on y était accueilli, dans les cafés, on pouvait rencontrer des artistes de renommée mondiale. Cela a attiré de nouveaux artistes et a fait de Paris vraiment cette espèce de melting pot qui attirait de nombreux artistes à venir. »
Qui fréquentent-ils ces artistes tchèques à Paris ? Quelles personnalités ? Vous en avez cité quelques-unes, évoquant Maurice Utrillo et Suzanne Valadon. On peut rappeler d’ailleurs à cette occasion que Suzanne Valadon a posé pour un personnage du fameux rideau du Théâtre National à Prague. Il y avait déjà ce lien entre la Bohême et la France.
« J’ai déjà évoqué les amitiés de Georges Kars dans le milieu artistique de Montmartre. Coubine était un peu plus reclus, mais il avait son marchand Basler et fréquentait un peu plus, je pense, la colonie tchécoslovaque à Paris. Tout au long des années 1920 et 1930, Kars a eu pour sa part un rôle de passeur entre l’association Mánes et ses amis peintres tchèques et a permis d’organiser ici à Prague une grande exposition consacrée à l’Ecole de Paris sans être particulièrement actif dans la colonie tchécoslovaque par ailleurs. Eberl, lui, vivait sa vie avec quelques amitiés, mais sans rechercher vraiment à côtoyer les Tchèques. Il était très intégré au milieu parisien. »
« Il y a aussi une autre personne qu’il faudrait mentionner dans ce cadre et qui était voisin de Kars à Paris, c’était Richard Weiner, qui était correspondant de Lidové noviny : dans l’exposition, il y a un portrait de Richard Weiner par Kars, parce qu’ils étaient voisins. Weiner écrivait pour Lidové noviny et le public tchèque des comptes rendus de toutes les expositions de ces artistes à Paris. C’est également le premier qui a informé les Tchèques de la naissance du surréalisme et de toutes les choses qui se passaient sur la scène artistique parisienne. »