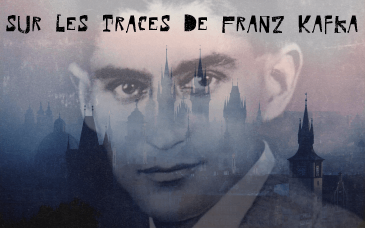Interhelpo : une utopie communiste tchécoslovaque dans les steppes kirghizes
Il était une fois des Tchèques et des Slovaques rêvant d’un monde meilleur qu’ils auraient édifié à la force de leurs bras et de leur volonté. Le 29 mars 1925, plusieurs centaines de ces jeunes gens, souvent des couples avec enfants, embarquaient dans un train à Žilina. Destination : le Kirghizistan soviétique où, croyaient-ils, leurs lointains camarades les attendaient afin de contribuer à la création de ce paradis des travailleurs. La coopérative Interhelpo qu’ils représentaient devait ainsi être une des chevilles ouvrières permettant le développement du pays. Mais, en dépit de quelques succès tardifs, ni l’arrivée dans les steppes kirghizes ni l’évolution de la situation politique de l’URSS dans l’entre-deux-guerres n’ont été à la hauteur des attentes. Cette épopée utopiste tchécoslovaque a été retracée par le journaliste slovaque Lukáš Onderčanin dans son livre intitulé : Une utopie dans le jardin de Lénine : la commune tchécoslovaque Interhelpo.
« J’ai commencé à travailler sur ce projet Interhelpo lors d’un voyage touristique au Kirghizistan. J’y étais allé pour faire du trek, de l’équitation, etc. À l’époque, je savais déjà que plus d’un millier de Tchécoslovaques étaient partis au Kirghizistan il y a 100 ans et y avaient créé des fabriques et une coopérative, mais je n’en savais pas davantage. Je savais aussi qu’Alexander Dubček avait grandi là-bas. J’en ai parlé à mes amis avec lesquels je voyageais et ils étaient tellement intéressés qu’ils m’ont un peu poussé à commencer à écrire le livre ou à approfondir le sujet un peu plus que je ne l’avais peut-être prévu au départ. C’est donc l’une des raisons de départ de mon intérêt. Une autre raison est que les Slovaques et peut-être même les Tchèques ne savent pas grand-chose sur cette histoire, alors qu’il s’agit d’un épisode fondamental et très intéressant de notre histoire commune. »
Comment est née l’idée de créer cette commune ou cette coopérative appelée Interhelpo ? On peut déjà rappeler le contexte : nous sommes à ce moment-là dans les premières années suivant la fin de la Première Guerre mondiale, avec de nombreuses difficultés dans la société. Et un personnage en particulier, Rudolf Mareček, va jouer un rôle important…
« Interhelpo était avant tout un projet du parti communiste, ou plutôt d’un communiste particulièrement enthousiaste, Rudolf Mareček. Il était originaire de Moravie, mais dans les années 1920, au moment de la création de la Tchécoslovaquie, il a beaucoup voyagé. Il a notamment été en Asie centrale et était un grand admirateur de la Russie soviétique. Lorsqu’il est revenu en Tchécoslovaquie, il a voulu promouvoir cette idéologie. Mais à l’époque, la Tchécoslovaquie n’était pas très réceptive à ce genre d’idées, et les communistes étaient un peu marginalisés. C’est pourquoi il a décidé, probablement avec l’aide de l’Union soviétique elle-même, de motiver des gens à s’installer dans ce Kirghizistan soviétique et de contribuer au développement du pays. Et dans le même temps, il se trouve que la vie n’était pas très facile pour les travailleurs en Tchécoslovaquie, en lien notamment avec une crise financière assez importante. Il était relativement facile de motiver des gens ordinaires à vendre tous leurs biens, principalement leur maison et quelques vêtements, et à partir en Asie centrale pour créer une coopérative d’entraide où tout le monde aurait de tout, où ils travailleraient pour eux-mêmes, où ils gagneraient leur vie et où ils posséderaient tout en partage. L’idée d’une coopérative au pied de belles montagnes semblait donc très idéaliste et utopique. Mais bien sûr, la réalité a été un peu différente et beaucoup plus difficile que ce qu’ils imaginaient au départ. »
Le rêve d’une langue universelle
On reviendra évidemment là-dessus. Mais j’aimerais avant cela m’attarder sur un aspect insolite de ce projet qui allait de pair avec l’idée d’une langue universelle qui servirait aux gens de la commune. Cette langue était l’ido, un dérivé de l’espéranto, et d’ailleurs le mot « Interhelpo » est l’acronyme en ido de : Internacia laboristal helpo (Aide internationale aux travailleurs).
« La plupart des gens connaissent l’espéranto, mais cette langue avait aussi une sorte de version réformée appelée ido. Pour autant que je sache, quelques centaines de personnes le parlent aujourd’hui dans le monde. Rudolf Mareček était un grand fan de l’ido et il a fondé des clubs d’ido en Slovaquie, à Vienne et en Bohême. Il y avait cette idée que tous ces gens venus de différents pays et qui décidaient de migrer, auraient ainsi une langue commune. Pendant un certain temps, même la Russie soviétique a promu cette idée d’une langue commune et universelle pour tous les travailleurs et prolétaires du monde entier. Seulement une fois arrivés au Kirghizistan, où les conditions de vie étaient extrêmement difficiles et où il fallait lutter pour sa survie, peu de gens ont eu la motivation d’apprendre une nouvelle langue – d’autant plus qu’en général, il s’agissait de Tchèques, de Slovaques, voire de Hongrois et d’Allemands, et tout le monde se comprenait plus ou moins. L’idée de combiner le projet de coopérative avec la langue ido est finalement tombé à l’eau très vite, faute d’efficacité. »
Comment les autorités tchécoslovaques, qui devaient délivrer les passeports, voyaient-elles ce projet et comment percevaient-elles toutes ces personnes qui voulaient quitter le pays ?
« Il y a eu différentes approches. D’un côté, l’État était assez restrictif à l’égard des personnes qui présentaient ces opinions communistes, il y avait donc des perquisitions et parfois les autorités ne voulaient pas leur délivrer de passeport du tout. D’un autre côté, certains disaient parfois qu’il valait mieux se débarrasser de ces éléments considérés comme perturbateurs et qu’il valait mieux qu’ils vivent loin de la Tchécoslovaquie. Ces réactions différentes s’illustrent bien dans le cas du fondateur de la coopérative, Rudolf Mareček lui-même : celui-ci a toujours affirmé n’avoir pas obtenu de passeport des autorités qui lui auraient rendu la vie difficile. La question est de savoir s’il est vrai qu’il n’a pas obtenu de passeport et si c’est la raison pour laquelle il n’a pas rejoint le Kirghizistan et la coopérative Interhelpo qu’il avait créée. Même dans mon livre, la question reste ouverte : nous ne savons pas exactement comment cela s’est passé, mais nous savons en tout cas que les autorités ont essayé de compliquer un peu les choses au début. »
Tout plaquer et partir loin
Il y a exactement cent ans, le 29 mars 1925, le premier convoi de Tchèques et de Slovaques partait de Žilina, sur le territoire slovaque, pour cette destination lointaine qu’était le Kirghizistan, avec pour objectif de créer cette coopérative et de contribuer à l’édification d’un nouveau monde en Union soviétique. Il y a eu d’autres convois par la suite, dont un qui est parti de Brno - quatre en tout. Mais j’aimerais me concentrer sur ce premier convoi. Ces Tchécoslovaques ont fait un très long trajet avec de nombreux aléas. Après environ un mois, ils arrivent enfin à destination, cette destination rêvée. Que voient-ils en arrivant ? Est-ce le paradis que leur a promis Rudolf Mareček ?
« Ce n’était pas du tout le paradis. Au bout d’un mois de voyage, ils se sont retrouvés dans les environs de Bichkek. À l’origine, l’Interhelpo devait être fondé dans une autre région du Kirghizistan, un peu plus fertile et plus belle. Là, ils arrivaient fin avril, dans une région où il neigeait encore. Il faisait froid et, surtout, personne ne les attendait sur place, car tout ce projet d’entraide s’est effondré dès leur arrivée : les autorités locales ne comprenaient même pas ce projet de commune et n’avaient pas la capacité d’accueillir soudainement ces gens dans la ville relativement petite et peu développée qu’était Bichkek à l’époque. Il s’agissait de 300 personnes, arrivant chargées de machines et de tout le reste. Les premiers mois ont donc été extrêmement difficiles, notamment en raison du climat. Il y avait la sécheresse, le vent, la neige... Ça n’a donc été un paradis pour personne. Beaucoup de gens ont fait demi-tour très rapidement et ont découvert qu’ils avaient été trompés d’une manière ou d’une autre. D’autres sont restés parce qu’ils n’avaient souvent plus rien après avoir tout vendu avant de partir. Plus rien ne les attendait en Tchécoslovaquie. Ils étaient déterminés à essayer de survivre d’une manière ou d’une autre, sachant que l’idéologie était souvent importante pour eux. Ils se sont dit qu’ils s’attendaient à ce que ce ne soit pas facile au début et ont donc dû repartir de zéro. Et finalement, ils sont parvenus à construire une coopérative relativement prospère. »
Après la désillusion, quelques succès malgré tout
On découvre dans votre livre que les conditions de vie de tous ces gens les premiers mois sont terribles. Ils arrivent dans le froid, mais très vite les fortes chaleurs arrivent et de nombreux enfants commencent à mourir du typhus et de la malaria. Des adultes aussi, mais ce sont surtout les enfants qui payent le prix fort…
« Le problème, c’est qu’au début, ils ont été logés dans un vieux camp où avaient séjourné des prisonniers originaires d’Autriche-Hongrie. Il est intéressant de constater qu’ils se sont retrouvés dans un endroit où leurs compatriotes avaient peut-être séjourné quelques années auparavant. Les enfants vivaient dans des conditions très difficiles, où l’eau, notamment, était très mauvaise. Tous ces gens n’avaient souvent aucune expérience du voyage, que ce soit à l’étranger, ou même à l’autre bout de la Tchécoslovaquie. Alors, imaginez aller vivre en Asie centrale, où le climat est complètement différent, c’était quelque chose de difficile pour leur organisme. De plus, ils n’avaient même pas emmené de médecin avec eux, ce qui montre que l’organisation n’était pas vraiment au point. Voilà donc les problèmes auxquels ils ont dû faire face tout au cours de la première année : même lorsque le deuxième convoi est arrivé, tout n’était pas encore mis en place. Au moins 12 enfants sont morts au cours des trois premiers mois, et d’autres personnes ont attrapé des maladies comme le typhus, la tuberculose et autres. »
Ce n’était donc pas le paradis promis et espéré. Mais ont-ils réussi tout de même à faire quelque chose sur place, à construire des ateliers et des fabriques comme ils l’escomptaient ?
« Au bout d’un an, un an et demi, la coopérative a commencé à être plus autosuffisante et à connaître un certain succès. Elle a construit divers ateliers, serrurerie, tannerie ou menuiserie, et a commencé à vendre ses produits aux Kirghizes et aux Russes qui vivaient à Bichkek. Peu à peu, Interhelpo est devenue l’une des coopératives les plus prospères de tout le Kirghizistan soviétique. On peut donc dire qu’ils ont connu un certain succès et qu’ils ont été relativement autosuffisants pendant un certain temps, mais bien sûr, cela dépendait aussi beaucoup de la situation politique. Parallèlement à tout cela, il y avait toujours une lutte de pouvoir assez forte entre les membres de la coopérative et ceux qui voulaient exercer une fonction politique. On peut donc dire que ça a été une coopérative prospère pendant un certain nombre d’années, mais qu’en parallèle, il se passait beaucoup de choses négatives qui ont influencé ce qui s’est passé plus tard dans les années 1930, à l’approche de la Seconde Guerre mondiale. »
D’amis à ennemis
Vous évoquez en effet les années trente qui correspondent à l’avènement du stalinisme, avec des purges menées dans l’ensemble de l’Union soviétique. Comment ce régime répressif considère-t-il les Tchécoslovaques de l’Interhelpo ? Ce sont après tout des étrangers, mais en même temps ce sont aussi des communistes ou sympathisants communistes…
« Le stalinisme a fondamentalement changé la perception de ces étrangers. Au début, les communistes accueillaient volontiers des étrangers qui voulaient les aider à développer le pays, ce que les Tchécoslovaques ont fait dans le cadre de la coopérative Interhelpo. Et ils ont d’ailleurs fondamentalement contribué au développement du Kirghizistan et de Bichkek. Mais soudain, ils sont tous devenus suspects, parce qu’ils étaient étrangers et parlaient une autre langue. Le stalinisme est allé de pair avec une grande paranoïa : ces gens ont commencé à se dénoncer les uns les autres, même ceux qui utilisaient l’ido et l’espéranto. Tout le monde est devenu un ennemi. Même la coopérative Interhelpo est devenue suspecte : ces personnes ont été contraintes de renoncer à leur citoyenneté tchécoslovaque, d’adopter la citoyenneté soviétique, ou de rentrer chez eux. Il y a donc eu une première grande vague de retours en Tchécoslovaquie avant même le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. C’est notamment le cas d’Alexander Dubček qui a quitté l’Interhelpo et l’Union soviétique. Peu à peu, la répression s’est intensifiée : j’ai même trouvé des preuves du fait que ces personnes se dénonçaient entre elles parce qu’elles avaient des soupçons. Parfois, c’était sur la base de choses stupides : quelqu’un faisait des blagues sur Staline et quelqu’un d’autre le dénonçait parce que la paranoïa était si forte que si on ne le faisait pas, quelqu’un d’autre le ferait. C’est donc quelque chose qui a contribué à la désintégration de la coopérative et qui l’a détruite vers la fin. »
J’en profite pour évoquer la personnalité d’Alexander Dubček, figure marquante du Printemps de Prague et du communisme réformateur en 1968. Peut-on dire que son expérience de jeunesse au Kirghizistan a marqué sa personnalité et son parcours politique ?
« En partie, probablement. Même s’il faut rappeler tout de même qu’il y a évolué en tant qu’enfant. Je pense qu’il avait environ trois ou quatre ans lorsqu’ils sont arrivés au Kirghizistan, et c’était donc vraiment les premières années de sa jeunesse. Dans ses mémoires, il se souvient de certains moments, à la fois les plus amusants avec les promenades à dos de chameau, mais aussi les plus difficiles, par exemple, lorsque la collectivisation a commencé, que des Ukrainiens ont été déportés au Kirghizistan et qu’ils ont vu, non loin de la coopérative, la gare où arrivaient ces convois de déportés, avec des cadavres tombant du train. Cela a certainement eu un impact sur sa perception de la situation. Il n’est pas beaucoup revenu sur tout ça par la suite, mais par contre il a aidé beaucoup de gens de la coopérative à retourner en Tchécoslovaquie. Mais il est difficile de dire si cela a eu une influence directe sur sa politique. Je pense que cela a au moins façonné son enfance. »
En tout cas, cette expérience ne lui a pas fait rejeter l’idéologie communiste. Qu’en est-il des autres personnes de la coopérative ? Notamment les adultes qui ont vécu de près la répression, les purges, ceux qui ont été témoins des déportations de masse ? Est-ce que ce qu’ils ont vécu au Kirghizistan a fait évoluer la façon dont ils voyaient l’idéologie communiste ?
« Je pense que c’est très individuel. Dès le début, certains sont partis pas tant pour des raisons idéologiques, mais parce qu’on leur a promis des revenus plus faciles, une vie décente, un emploi et de l’argent. Ils ne se préoccupaient pas trop d’être communistes ou pas. Ceux-ci ont été marqués par le fait que ce régime et cette idéologie les ont laissés tomber, et ce sont ces personnes qui ont généralement été les premières à quitter la coopérative. Et puis il y a eu des personnes qui, malgré les purges, malgré la crise de l’économie stalinienne, maintenaient que le régime était bon, que la coopérative Interhelpo était très importante de même que l’arrière-plan idéologique du projet. Ceux-là n’ont pas changé d’avis même vers la fin. A Bichkek, j’ai parlé à quelques-uns des descendants de ces gens de la coopérative, et beaucoup d’entre eux voyaient encore tout cela de manière très idéalisée. »
Une utopie à l’épreuve du réel
1943 correspond à l’année où la coopérative Interhelpo a été dissoute. Que s’est-il produit exactement ?
« Progressivement, les Tchécoslovaques ont quitté la coopérative. Ils ont commencé à embaucher de plus en plus de travailleurs locaux, des Kirghizes, mais surtout des Russes ethniques, et progressivement, le projet est passé entre les mains des autorités locales, ce qui lui a fait perdre de son importance et la coopérative a été intégrée à l’économie soviétique. De nombreuses personnes ont défendu cette transition, disant que c’était le projet depuis le début, de commencer quelque chose sur place, de le développer et ensuite de le laisser à l’État. D’autres au contraire critiquaient le fait qu’on leur ait pris ce qu’ils avaient construit par eux-mêmes. Les opinions étaient donc très diverses. En tout cas, la coopérative Interhelpo a été dissoute et incorporée dans l’économie soviétique : les différentes fabriques ont subsisté pendant de nombreuses années, mais elles étaient désormais gérées par l’État lui-même et non par les Tchécoslovaques. Je pense que même l’État soviétique n’était pas ravi de voir des étrangers organiser et gérer quelque chose, et c’était donc aussi la raison pour laquelle la coopérative a été dissoute. »
Vous disiez avoir pu discuter avec des descendants au Kirghizistan. Quelle est la proportion de ceux qui sont repartis et de ceux qui sont restés ?
« Il y a eu plusieurs vagues de retours vers la Tchécoslovaquie. Les premières ont eu lieu dès le début, il s’agissait de personnes déçues qui n’ont pas réussi à rester sur place. Ensuite, ce sont les personnes parties pour gagner de l’argent là-bas qui sont revenues, même si souvent elles n’ont pas récupéré leur apport de départ, ou qu’il a fallu plusieurs années et un passage devant la justice pour qu’on leur paye leur part. La vague suivante de retours a eu lieu quand les répressions ont commencé et que les gens ont été contraints de renoncer à leur citoyenneté. Une fois la coopérative dissoute, encore dans les années 1960, de nombreuses personnes ont essayé de rentrer en Tchécoslovaquie, et cela a duré jusqu’à l’effondrement de l’Union soviétique quand les conditions se sont assouplies. Même Dubček les aidait encore à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Je connais des gens qui ne sont revenus ici que vers l’an 2000. Aujourd’hui, c’est une communauté relativement restreinte qui vit à Bichkek. J’ai parlé à une dame qui est décédée il y a quelques années. Bien qu’ayant grandi au Kirghizistan avec des parents slovaques, elle maîtrisait déjà très mal la langue, mais elle la comprenait. Je pouvais lui parler en slovaque, mais elle ne pouvait me répondre qu’en russe. Je n’ai plus rencontré personne là-bas qui continuait à pratiquer la langue : tant le tchèque que le slovaque ont fini par disparaître. Malgré les quelques personnes qui se réunissent tous les ans pour commémorer la coopérative, le souvenir de cette épisode disparaît. »
Pour votre livre, vous avez choisi un genre particulièrement intéressant : ni roman, ni livre d’histoire académique, il s’agit davantage d’une sorte de long reportage historique, dont le récit est scandé par des documents et des photos, et qui est très agréable à lire. Comment avez-vous opté pour cette forme de récit ?
« Je suis un fan de ce genre de reportages historiques, et je pense que c’est un bon moyen de rendre l’histoire aussi vivante que possible pour le lecteur. Je ne suis pas historien à la base, donc je devrais probablement avoir plus d’expérience dans cette discipline si je voulais le faire en tant qu’historien. Or ce n’était pas mon but non plus. Deuxièmement, j’aurais probablement eu besoin de beaucoup plus de temps pour examiner tout cela d’un point de vue historique. J’ai consulté deux fois les archives de Bichkek, même s’il aurait fallu une autre visite parce qu’il y a des dizaines de milliers de documents. Ce genre était aussi un compromis entre la façon de raconter l’histoire de manière intéressante, de s’en tenir aux faits historiques, mais en même temps, parce que je suis aussi journaliste, avec le reportage. Le récit doit être appuyé par des faits, sauf que certains d’entre eux sont souvent difficiles à vérifier. Nous supposons qu’ils sont vrais, mais il y a des choses qui sont passées par le filtre de la littérature parce qu’il y avait des écrivains célèbres passés par l’Interhelpo comme Petr Jilemnický ou Julius Fučík qui ont écrit à ce sujet. Donc pour certaines choses, je ne sais pas à 100 % si elles se sont produites exactement telles qu’elles ont été écrites, mais on peut supposer qu’elles se sont produites. C’est pourquoi le genre que j’ai choisi se situe quelque part entre le reportage et le livre historique, et je serais heureux si un historien venait le compléter de manière plus professionnelle. Je pense vraiment que c’est un sujet qui doit être traité, peut-être de manière moins idéologique qu’au siècle dernier, et il a certainement quelque chose à offrir aux historiens contemporains également. »