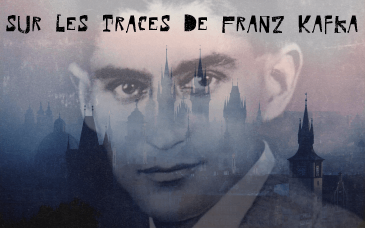Renata Libal : « Ce n’est que dans l’avion d’Alger que mes parents m’ont dit qu’on émigrait en Suisse »
Entretien avec Renata Libal, née Líbalová à Prague, journaliste suisse et auteure d'un nouveau livre intitulé Tchéquie - la nostalgie n'est jamais légère, qui vient de sortir aux éditions Nevicata dans la collection L'âme des peuples. Renata Libal est aujourd'hui rédactrice en chef du magazine suisse Encore, publié en français et en allemand. Son père, René Líbal, est un ancien rameur de renom qui a participé deux fois aux Jeux olympiques et a décidé de partir développer l'aviron dans une Algérie nouvellement indépendante, où il a emmené la famille. D'Alger, les Líbal ont décidé d'émigrer vers Lausanne quelque temps après l'invasion de la Tchécoslovaquie de 1968.
Extraits de cet entretien à écouter dans son intégralité en appuyant sur Lecture
Renata Libal : « Mon père était un sportif d’élite de la Tchécoslovaquie. Et à ce titre, à l’époque, l’Algérie socialiste demandait à des pays frères de l’aider à développer ses infrastructures sportives dont ils avaient bien compris l’impact en termes d’image et de propagande. Donc, une multitude de sportifs ainsi que de médecins aussi. Ils sont partis là-bas comme coopérants. Et mon père est allé développer l’aviron en Algérie. Donc, il a fondé le Rowing Club Alger, puis le Rowing Club d’Oran, puis les Algériades qui opposaient le Rowing Club d’Alger au Rowing Club d’Oran. »
C’était juste après l’indépendance de l’Algérie. Ça devait être une période incroyable ?
« C’était une période incroyable. Et la famille a gardé des rapports aussi étroits qu’il a été possible avec l’Algérie, parce que les jeunes qui ramaient avec lui avaient l’impression de vivre une période où tout était possible. »
« L’Algérie n’est pas du tout faite pour être un pays d’aviron. Pour ramer, il faut une surface d’eau plate et longue et la mer n’arrêtait pas de faire des vagues. Mais néanmoins mon père a réussi à trouver des moments dans la journée où, dans le port, l’eau était plus calme. Il faisait lever ses rameurs à 5 heures du matin pour être là à l'heure. Et eux avaient cette espèce d’impression qu’ils pouvaient ramer en Algérie, participer à des compétitions, le monde s’ouvrait, tout était possible. L’avenir a montré que ce n’était pas tout à fait le cas, mais c’était une période d’euphorie incroyable. Et j’ai des photos de ma maman en pantalon corsaire orange dans le port d’Alger. Il était tout à fait normal d’être une femme occidentale en manches courtes et pantalon corsaire orange. »
Et vous précisez qu’il y avait des activités pour un peu soutenir l’idéologie communiste à l’époque, que vos parents refusaient, rejetaient ?
« C’était un peu compliqué parce qu’au début, quand on est arrivés en 1967, j’ai été à l’école francophone et on était vraiment dans une logique d’apprentissage du français. Après l’invasion russe de la Tchécoslovaquie en 1968, on a obligé un peu tous les enfants des coopérants à être inscrits à l’école de l’ambassade tchécoslovaque, dans une classe à multiples niveaux où c’était l’épouse de l’ambassadeur qui donnait les cours... »
« Et le dimanche, il y avait des activités encadrées, un bus qui venait ramasser tous les coopérants et on partait faire une excursion. Et mes parents avaient régulièrement malheureusement la migraine, ou l’excuse qu’un tel s’est foulé la cheville, enfin bref. Ils ont un peu boycotté ce genre d’activités et ils ont remarqué qu’ils étaient sous surveillance. »
« Quand il s’est agi dans cette classe de l’ambassade de distribuer les disciplines, parce qu’il y avait une distinction à l’époque, les ‘étincelles’ qui étaient en fait la première étape des pionniers, la maîtresse nous avait bien expliqué que tous les enfants méritant allaient recevoir une étincelle (jiskřička en tchèque), ça allait être super, et puis on verrait à quel point on était de bons communistes, de bons élèves et de bons éléments. Et on était deux dans la classe à ne pas la recevoir, moi j’étais totalement effondrée parce que qu’avais-je fait de mal, j’avais des bonnes notes, pourquoi je n’avais pas mérité ma jiskřička ? Et c’est là que mes parents se sont dit, oups, il va falloir jouer serré pour partir, et en fait à la fin de leur contrat, ils ont pris deux billets d’avion, un pour Prague et un pour Paris, et les deux avions partaient à peu près au même moment, et ils ont réussi un peu à flouter ce départ, et à venir rejoindre la Suisse où d’autres coopérants s’étaient déjà installés avant nous, donc on a reconstitué une espèce de petite famille à Lausanne. »
La filière des Tchécoslovaques d'Alger vers la Suisse
Et entre-temps, pendant l’invasion russe de la Tchécoslovaquie dont vous parliez, vous êtes vous-même à Prague, petite fille à ce moment-là - une expérience je suppose traumatisante et qui vous a sûrement fait percevoir différemment l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022. Avez-vous perçu des différences entre votre réaction et la réaction de gens autour de vous à Lausanne, qui ne voyaient peut-être pas les choses de la même manière ?
« Très clairement. J’ai quand même grandi dans un monde où la méfiance vis-à-vis du ‘grand frère russe’, comme on disait à l’époque, est très viscéralement et profondément ancrée, alors qu’évidemment en Suisse, il y a quand même une tendance à relativiser et je me sens effectivement beaucoup plus intransigeante par rapport à ça : il n’y a aucune raison historique, il y a une frontière qui n’avait pas à être franchie, et il y a un droit international sur lequel on ne peut pas revenir, et qui était le garant de la paix. Je suis effarée maintenant de la légèreté avec laquelle on traite toute l’Organisation des Nations Unies, tout le droit international qui a été une idée de la démocratie, qui a été montée sur l’idée du « plus jamais ça après la guerre », et donc où on trouve beaucoup d’excuses. D’ailleurs, à gauche et à droite, dans la palette politique...
En Suisse également ?
« Ce ne sont pas des voix très fortes. La Suisse soutient très clairement l’Ukraine, mais on entend de plus en plus de voix, y compris d’intellectuels, qui nuancent, qui trouvent qu’il faut revenir à l’histoire, expliquer, et ne pas diaboliser. Donc ce type de discours, on l’entend quand même. »
Lausanne, vous l’avez dit, n’était pas un choix fait par hasard par vos parents en 1970. Je crois que votre père a eu d’abord des opportunités pour aller entraîner des équipes d’aviron dans d’autres pays francophones, la France ou le Canada même. Il y a ce moment où vos parents se décident - d’ailleurs vous n’êtes pas au courant - pour la Suisse, parce que d’autres y étaient partis avant eux. Ce sont des Tchécoslovaques d’Alger aussi ?
« Des Tchécoslovaques d’Alger, oui, il y a eu une espèce de filière. Le premier dont le contrat arrivait à échéance a fait un peu le raisonnement, OK, où est-ce qu’on va ? On a commencé à apprendre le français, là il y a un pays neutre au milieu de l’Europe, ce n’est pas trop loin. »
Vous, vous avez été surtout choquée d’apprendre que vous ne rentriez pas d’Alger à Prague voir votre grand-mère…
« Absolument, moi je l’ai appris dans l’avion, mes parents n’ont pas osé me le dire avant. Et ils avaient évidemment bien raison, parce que je l’aurais dit, sous le sceau du secret le plus absolu, à tous mes copains de classe… Donc tout le monde a choisi un peu le pays neutre au milieu de l’Europe où on parlait le français, en se disant que c’était l’affaire de quelques années. Et il y a eu donc un certain nombre, je ne sais pas, je dirais une douzaine de familles, qui ont choisi cet itinéraire de l’Algérie à la Suisse. Il y avait une communauté. »
On y célébrait même Mikuláš, la Saint-Nicolas à la tchèque. Il y a des figures de l’immigration tchécoslovaque en Suisse, je pense à l’économiste Ota Šik notamment. Vous vous rappelez des gens ? Je sais que vous avez décrit avoir été très bien accueillis…
« Absolument, et c’était d’autant plus frappant, il y avait à l’époque une société d’amitié hélvéto-tchécoslovaque, qui était vraiment là pour l’accueil des nouveaux arrivés, qui nous avait à l’époque prêté une somme pour s’installer sans intérêt à rembourser dans je ne sais plus combien de mois, mais en fait il y avait vraiment pratiquement un comité d’accueil je dirais. »
« Ils étaient vraiment incroyables, très encadrants et le contraste pour moi était d’autant plus frappant que je me suis retrouvée en classe avec d’autres étrangers, essentiellement des Italiens à l’époque, fils d’ouvriers sur les chantiers, et je voyais bien la différence de traitement. Je n’ai pas été d’un grand courage, je ne me suis pas interposée en disant nous sommes tous les mêmes, j’ai un peu pris mes distances, mais j’ai bien compris que j’étais de ‘l’immigration haut de gamme’, parce que moi je fuyais le communisme, alors qu’eux ils venaient chercher du travail. Donc j’avais des parents de formation universitaire, eux pas, il y avait quand même un encadrement, des exigences scolaires ou à la maison, ce qui n’était pas forcément leur cas, et je voyais bien que le regard était extrêmement différent. »
« Vous sortez de ma bagnole, vous êtes une émigrée, vous avez trahi le pays ! »
Vous faites toute votre scolarité en Suisse. Le temps nous est un peu compté donc nous passons directement à l’année 1989. Est-ce que vous vous souvenez de ce mois de novembre 1989 et de la révolution de Velours à Prague ?
« Eh bien, je crois que j’ai passé ce mois de novembre sur le canapé, les yeux rivés à la télévision. »
À Lausanne ?
« À Lausanne, je commençais, c’étaient mes premières années en tant que journaliste indépendante, j’essayais de rentrer dans les rédactions, donc je n’ai pas couvert, journalistiquement parlant, mais j’avais les yeux rivés sur cet écran et je suis revenue pour la première fois en famille pour Noël 1989, retrouver aussi cette famille qu’on n’avait pas vue pendant toutes ces années, donc avec mon père, ma mère et mon frère. »
Et ce premier Noël, alors ?
« Alors évidemment, on est arrivés dans cette Prague grise, morne, il faisait tellement froid, on n’arrivait pas à trouver un café ouvert, parce que, disons, en termes de qualité d’accueil, ce n’était pas exactement ça que le communisme prônait. Donc des dames pipi détestables dans les cafés où on vous montrait bien que vous étiez un émigrant, parce que ça se voyait aux vêtements, etc. »
« Après j’ai commencé à faire des reportages ici et une fois j’ai fait un reportage sur la vie nocturne pragoise, je suis rentrée en taxi et le chauffeur n’avait pas réalisé au départ que j’avais un accent, puis après j’ai fait une faute de grammaire quelconque et tout à coup il m’a dit « mais attendez, vous habitez où, vous ? » J’ai dit que j’habitais en Suisse, il a appuyé sur les freins, il m’a dit « vous sortez de ma bagnole, vous êtes une émigrée, vous avez trahi le pays, etc. » Je me suis retrouvée à 3h du matin dans les environs de Prague, au bord de la route, avec le pouce levé, ça a été un petit moment... »
« Voilà, je n’avais pas mesuré que la hargne pouvait être aussi virulente des années plus tard, avec ce sentiment de gens qui ont été... qui se sont sentis lâchés par des profiteurs, alors ce n’est pas évidemment pas comme ça que nous nous sommes perçus, et ce n’était pas les raisons de l’exil. Mes parents ont vraiment... mon petit frère est né en 1968, quelques jours avant l’arrivée des chars, ici à Prague, et je crois que ça a été vraiment un déclencheur dans la décision de mes parents de partir, de ne pas faire de la chair à canon pour le pacte de Varsovie. »
Cette scène et la difficulté du retour des émigrés nous ramènent à Kundera. L’allusion à l'auteur de L'insoutenable légerté de l'être est assez claire dans le sous-titre de votre livre, « Tchéquie, la nostalgie n’est jamais légère », ce n’est pas par hasard. Il est rarement facile ce retour, vous avez décrit cette scène. Vous a-t-on bien accueillie sinon ?
« Oui, c’était effectivement... là c’est vraiment l’exemple le plus désagréable que j’ai eu à vivre, mais globalement j’ai quand même trouvé que les gens étaient très... soucieux du dialogue, avaient envie, et je suis très sensible à l’énergie qu’il y a de plus en plus à Prague, et je suis très touchée par cette envie d’ailleurs, où on voit vraiment un pays qui s’ouvre, mais en même temps une force très... vraiment une puissance des racines et de l’authenticité. Même les restaurants chics qui y ouvrent, ils gardent une manière de twister les ingrédients de la cuisine de la Première République, donc on a l’impression qu’ils prennent un peu le meilleur des deux mondes. Je trouve que ça évolue maintenant d’une façon extrêmement positive. On sentait les prémices dès le départ, mais évidemment il a fallu un peu de temps. »
Alors peut-être que c’est là qu’on sent que vous êtes une émigrée, d’abord parce que vous n’aimez pas la bière, et puis aussi parce que vous décrivez les knedlíky, comme des « éponges à sauce », blasphème !
« Je crois que ce sont vraiment désespérément des éponges à sauce, c’est terrible, cette chose n’a pas de goût, j’aime beaucoup de choses de la cuisine tchèque, je suis une grande fan des buchtičky, mais alors franchement les knedlíky, on peut vivre sans. »
Parlez-nous des reportages que vous faisiez, c’était notamment pour l’Hebdo, c’est bien ça ? Est-ce que vous avez des anecdotes de reportages à cette époque ? C’était donc début des années 1990 ?
« Un des reportages les plus fantastiques que j’ai eu l’occasion de faire était sur la manière dont Havel restituait les propriétés qui avaient été saisies par les communistes. Et donc j’étais revenue ici pour assister à la restitution d’un certain nombre de châteaux, et tout à fait par hasard, j’ai réussi à prendre contact avec un grand jeune homme élancé qui sortait, je crois que c’était Harvard, mais je ne suis pas très sûre, et qui était le prince Lobkowicz. Et c’était une journée vraiment très touchante où il y avait ce grand gaillard qui devait avoir une trentaine d’années. Ce qui est d’ailleurs très touchant est que dans le palais Lobkowicz l’audioguide est avec sa voix et celle de son épouse. On sent que c’est réel, c’est du vrai ici. »
Un comte, une écrivaine et un économiste
Alors ce n’est pas un Lobkowicz mais c’est un Kinský - qu’on connaît bien ici à Radio Prague Int. - que vous avez choisi pour l’un des trois entretiens inclus dans votre livre. Pourquoi ce choix d’abord de Constantin Kinský, ainsi que de l’écrivaine Kateřina Tučková et également de l’ancien vice-gouverneur de la banque centrale, Mojmír Hampl ? Vous les vouliez comme panel représentatif ?
« L’idée était d’avoir trois éclairages un peu différents. Donc je voulais absolument avoir une femme qui ait un regard sur le rôle des femmes dans l’histoire tchèque. Et je trouve que cette écrivaine Kateřina Tučková est absolument remarquable. Son tchèque est d’une pureté, d’une clarté ! C’est vraiment un bonheur à lire et sa spécialité à elle est de romancer, de placer ses romans dans des moments historiques, historiquement forts et souvent un peu méconnus de l’histoire tchèque. Et le dernier, Bilá voda, raconte le milieu des religieuses, la manière dont elles ont été réprimées pendant le communisme. Ce bouquin est absolument poignant. C’est un pavé et il est difficile à lire parce qu’il y a à la fois du vocabulaire religieux et du vocabulaire communiste. Mais il en vaut merveilleusement la peine. »
« Mojmír Hampl, ce que j’aime bien en lui, c’est cette énergie de construction. Il croit en l’avenir du pays. il est directeur du Conseil budgétaire tchèque (Národní rozpočtová rada), donc il est en contact avec toutes les entreprises et perçoit les énergies positives, tout ce qu’il y a à construire. Et je suis toujours très sensible aux gens qui voient le verre à moitié plein. Et Constantin Kinsky, j’avais envie de quelqu’un qui me parle de son aventure, arrivé de Paris à 30 ans pour reprendre un château au milieu de nulle part et en faire un centre culturel et aussi de cette gestion de ce domaine familial. Il est le plus grand propriétaire de forêts privées en Tchéquie. Il y a des forêts qui vont extrêmement bien comparées aux autres forêts gérées par l’État pendant toutes ces années. Je trouve que c’est une très belle histoire justement d’ancrage dans une continuité où il a un pied dans le passé et un pied dans le futur. »
Dans cette Suisse que vous connaissez si bien, c’est hélas un peu comme en France : la Tchéquie, on connaît peu, voire très peu et ce sont très souvent des clichés. Est-ce que dans l’écriture de votre livre, vous avez réussi à sortir de ces clichés qu’il faut quand même reprendre pour ceux qui ne connaissent rien à ce pays ? Et avez-vous découvert des choses que vous ignoriez totalement ?
LIRE & ECOUTER
« Je ne sais pas si j’ai réussi. En tout cas, j’ai essayé déjà de sortir de Prague parce qu’il y a une Tchéquie en dehors du Pont Charles. Et du coup, pour préparer ce livre, j’ai passé beaucoup de temps ici et j’ai plus voyagé que d’habitude dans le pays. J’ai vraiment été frappée par cette richesse qu’il y a partout. Que ce soit un héritage de noblesse dont je parlais tout à l’heure avec les châteaux, mais aussi des vestiges industriels. Et on sent ce pays qui a vraiment vibré d’une richesse à la fois culturelle, industrielle, créative, et ce dans toutes les régions du pays. Zlín avec Baťa, c’est incroyable. C’est un endroit qui a essayé vraiment de fonder une nouvelle manière de regarder l’entreprise, de responsabilité sociale. On peut maintenant traiter ça de paternaliste ou voilà. Mais il y avait vraiment une idée, une envie et ça reste, ça continue à vibrer. Il y a un institut des études Bata et de la philosophie Baťa sur place et qui continue à publier des livres sur ce que Baťa peut nous apprendre encore aujourd’hui. Donc, il y a une vivacité de tout ça que j’ai trouvée vraiment impressionnante. Et ce que j’aimerais beaucoup, c’est d’inciter les gens à venir et aussi à s’éparpiller un peu dans les campagnes et à quitter Prague un petit moment. »
Est-ce que dans ces campagnes, on perçoit également que vous avez un accent ? Est-ce qu’on vous demande d’où vous venez ?
« Oui, mais c’est une question qui est maintenant beaucoup moins pertinente qu’à l’époque parce qu’il y a quand même de plus en plus d’étrangers. On entend beaucoup plus d’accents en tchèque parce que les gens vont et viennent. Donc maintenant, on me pose la question beaucoup plus tard, pas la première fois que je trébuche sur une déclinaison. »
« Radio Prague, les ondes de la révolte : un film totalement merveilleux »
Avez-vous récupéré la citoyenneté tchèque ?
« Je vais aller chercher mon passeport demain. Ça a été laborieux parce que j’en avais déjà un, mais périmé. Ne jamais laisser échoir un document tchèque ! Donc j’ai mis deux ans à le récupérer et demain je vais avoir mon nouveau passeport. »
Vous êtes mariée mais vous avez gardé votre nom de jeune fille. Aimez-vous être appelée Líbalová quand vous êtes ici ?
« Oui, même si au final ils m’ont mis Libal sur le passeport. Je n’aime pas tellement le ová dans ce qu’il a d’appartenance puisque c’est « la dame qui appartient au Libal ». Mais je l’utilise quand même assez régulièrement comme signal pour dire que j’appartiens un peu ici. »
On se trouve dans les studios de la radio publique tchèque. Je sais que vous avez vu récemment le film Vlny intitulé en français Radio Prague, les ondes de la révolte. Est-ce un film qui touche particulièrement quand on a émigré après 1968 ?
LIRE & ECOUTER
« Absolument. C’est un film totalement merveilleux. Je l’ai vu avec mon mari et des amis, des amis suisses. J’étais la seule qui était un peu directement touchée par l’histoire. Mais ils ont pratiquement été aussi émus que moi. Je pense que c’est vraiment un message universel. Ce film est extraordinaire avec ce mélange de fiction et d’archives. Il est aussi extrêmement beau dans les lignes, dans cette architecture brutaliste qui a été en partie tournée ici à la radio et en partie dans le bâtiment Radost, avec ce grand escalier carré en marbre. Donc c’est beau, c’est intelligent, c’est fort, c’est puissant et c’est un message qu’on a besoin d’entendre. »