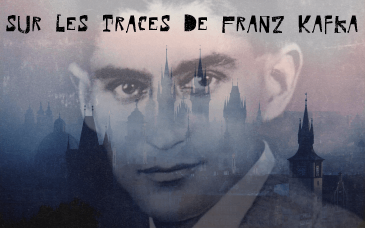Edvard Beneš : vie et mort de la République tchécoslovaque
Edvard Beneš est mort le 3 septembre 1948, il y a tout juste 65 ans, dans un lieu qu’il chérissait, sa villa située à Sezimovo Usti, dans le sud de la Bohême. Si les historiens débattent encore du rôle que le président de l’avant et de l’après-guerre a joué dans les événements souvent tragiques survenus dans la première moitié du XXe siècle, tous s’accordent néanmoins à dire qu’il a été un homme d’Etat d’une importance capitale pour la Tchécoslovaquie. Œuvrant aux côtés de son mentor, Tomáš Garrigue Masaryk, et du Slovaque Milan Rastislav Štefánik à la naissance de la première République tchécoslovaque, Edvard Beneš en est devenu ensuite le ministre des Affaires étrangères, puis le deuxième président. Suite aux accords de Munich en 1938, il a été un des acteurs du rapprochement avec la Russie soviétique, signé les décrets qui portent son nom au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour expulser les populations allemandes des Sudètes avant d’accompagner, malgré lui, le processus de la prise du pouvoir par les communistes.
Car des erreurs, Edvard Beneš en a très certainement fait un certain nombre, et le contraire aurait été étonnant dans une période de l’histoire si riche en événements tragiques. C’est sans doute pour cette raison que son rôle est aujourd’hui encore débattu, pas seulement par les historiens, et alimente parfois la controverse quand il sert le jeu des politiciens contemporains. Ainsi, lors du second tour de la première élection présidentielle au suffrage universel en janvier dernier, le candidat Miloš Zeman a accusé son adversaire Karel Schwarzenberg de vouloir traîner devant les tribunaux Edvard Beneš pour les traités éponymes ayant conduit à l’expulsion de 2,6 millions d’Allemands des Sudètes hors de Tchécoslovaquie de 1945 à 1947.
Au-delà de ce débat purement politicien, il a été reproché à Edvard Beneš d’utiliser des mots et des expressions très durs envers les Allemands, des mots et des expressions qui avaient une consonance particulière alors que l’on découvrait alors tout juste l’horreur des camps d’extermination nazis. Edvard Beneš parle ainsi de « liquidation du problème allemand ». Historien à l’Académie des Sciences, Jiří Dejmka souhaite remettre ces propos dans leur contexte :
« Quand Beneš s’est rendu dans la ville libérée de Brno, il a prononcé un assez long discours dans lequel il a utilisé l’expression ‘liquider le problème allemand’. Cela a évidemment une autre connotation que de dire ‘liquider les Allemands’. Toutefois, il a ensuite modifié son discours le 16 mai sur la place de la Vieille-Ville à Prague en disant que ‘nous voulons liquider les Allemands’. Mais il est très clair qu’il s’agit du sens originel de ‘liquider le problème allemand’ dans le cadre de l’Etat tchécoslovaque, et non en termes de liquidation physique des Allemands. »Il s’agit en fait d’une série de décrets signés par Beneš en l’absence, faute d’élections, de Chambre des députés et qui portent sur différents aspects de la politique tchécoslovaque. Appliquant un principe de responsabilité collective, les Allemands des Sudètes, accusés de collaboration avec les nazis, sont expulsés de leurs terres, parfois dans la violence. Quant au vocabulaire employé, l’historien Richard Vašek, de l’Institut Masaryk de l’Académie des Sciences, pense lui qu’il n’était pas aussi choquant à l’époque qu’il peut l’être aujourd’hui :
« Beneš utilisait ce mot de liquidation assez souvent, et ce bien avant les expulsions et même le début de la Seconde Guerre mondiale. Evidemment, aujourd’hui, c’est un mot spécial et personne ne l’utiliserait : liquider n’appartient pas au vocabulaire politique contemporain. »
Mais la carrière d’Edvard Beneš ne se résume à ces décrets si controversés. Elle débute bien avant la Seconde Guerre mondiale. C’est d’ailleurs durant la première qu’il se fait un nom. Grand francophile, titulaire d’un doctorat de droit à l’Université de Dijon en 1908, il enseigne par la suite la sociologie à l’Université Charles à Prague. Bénéficiant d’importantes réserves d’argent grâce à une tante de son épouse, il s’engage lors de la Grande Guerre afin de faire tomber l’Autriche-Hongrie des Habsbourg, maîtres depuis trois siècles du Royaume de Bohême. Une lutte qui n’est alors pas sans risques, comme le soutient l’actuel directeur du Musée national de Prague, Michal Lukeš :
« Edvard Beneš décide de suivre Tomáš Garrigue Masaryk en 1915. Il part à l’étranger, opérer à Londres puis à Paris. A cette époque, il n’a pas encore de famille, bien qu’il ait évidemment sa femme qui est restée en Bohême. Il se trouve dans une situation incertaine, puisqu’il s’active pour constituer dans une certaine mesure une nouvelle forme d’Etat et obtenir l’indépendance des pays tchèques. Et, évidemment, il ne pouvait pas savoir comment aller s’achever la Première Guerre mondiale. »Michal Lukeš laisse entendre que si l’Autriche-Hongrie avait été du côté des vainqueurs, le destin de Beneš aurait pu être tout autre. L’historien Michal Stehlik affirme dans sa suite que si l’historiographie tchèque et slovaque célèbre le rôle de ce farouche opposant aux Habsbourg dans la Première Guerre mondiale, il n’en va pas de même chez les spécialistes autrichiens.
Ainsi, Edvard Beneš est l’un des fondateurs de la Première République tchécoslovaque, aux côtés du général Milan Rastislav Štefánik et de son inspirateur Tomáš Garrigue Masaryk. Ce dernier déclare d’ailleurs que, sans Beneš, la naissance de cet Etat indépendant aurait été impossible. En 1918, Masaryk devient le premier président de la République tchécoslovaque, Edvard Beneš le ministre des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie tchécoslovaque, qui sera également président de l’Assemblée générale de la Société des Nations entre 1935 et 1936, a un grand rôle à jouer dans une Europe qui se cherche un équilibre et au sein duquel la place de la Tchécoslovaquie n’est pas évidente. On écoute l’historien et politologue Michal Pehr :
« Edvard Beneš considérait la Tchécoslovaquie comme s’il s’agissait de son enfant. En termes de politique étrangère, il a tout fait pour que l’existence de la Tchécoslovaquie soit assurée. Et, bien entendu, assurer l’existence d’un état comme l’était la Tchécoslovaquie dans l’entre-deux guerres n’était pas une chose aisée. Parce qu’en fait, aucun des pays voisins, à quelques exceptions près, ne souhaitait l’existence de la Tchécoslovaquie. Et bien sûr, assurer la politique internationale d’un Etat dans ces conditions est plus difficile. »De fait, la Tchécoslovaquie est un Etat quelque peu artificiel, réunissant des Tchèques de tradition hussite et tournés vers l’occident, et des Slovaques catholiques et plus inscrits dans l’Europe centrale et orientale ; deux peuples qui n’ont jamais cohabité par le passé. Le pays est de plus une mosaïque de minorités comprenant des Allemands, des Polonais, des Hongrois ou encore des Ukrainiens. Edvard Beneš inscrit son pays dans un système d’alliance militaire avec des Etats indépendants depuis peu, la Roumanie et la Yougoslavie. Se forme ainsi la Petite Entente, dont se rapproche bientôt la France et qui doit dissuader quiconque souhaite l’attaquer. Cet équilibre est cependant très fragile alors qu’Adolf Hitler prend le pouvoir en 1933 et ne tarde pas à afficher des velléités belliqueuses. Malade, Masaryk démissionne et c’est Edvard Beneš qui devient le second et dernier président de la Première République tchécoslovaque le 18 septembre 1935.
Pour ce francophile convaincu, les accords de Munich signés en septembre 1938, quand la France et la Grande-Bretagne abandonnent leur allié tchécoslovaque aux mains d’Hitler sont vécus comme une tragédie. Ils permettent à l’Allemagne d’annexer les Sudètes, puis d’occuper les pays tchèques constitués en un protectorat de Bohême-Moravie en mars 1939. C’est ce que rappelait récemment sur notre antenne l’historien français Alain Soubigou :« A titre purement personnel, pour le très francophile Beneš, qui non seulement a conduit la diplomatie jusqu’en 1935 mais aussi le pays puisqu’il devient président de la République en décembre 1935, c’est une déception atroce et il est un des premiers à faire le voyage de Moscou en 1943. Il sait que, désormais, il faudra tenir compte de la puissance soviétique. »
En octobre 1938, Edvard Beneš quitte à nouveau sa Bohême. Il rejoint Londres où il organise le gouvernement tchécoslovaque en exil. De gauche sans toutefois être communiste, il se rapproche de Staline et signe une entente en 1943 avec l’Union soviétique. Ces Soviétiques qui libèrent en grande partie les pays tchèques de la tutelle nazie deux ans plus tard. La Troisième République tchécoslovaque (la Deuxième République n’ayant pas fait long feu entre l’annexion des Sudètes le 1er octobre 1938 et l’occupation par les Allemands en mars 1939) est proclamée en 1945 et Edvard Beneš en devient le président. Rapidement affaibli par des problèmes de santé, il laisse du terrain aux communistes qui, forts d’un soutien populaire important, prennent finalement le pouvoir lors du Coup de Prague en février 1948. L’historien Michal Pehr raconte :
« Beneš était convaincu qu’après février 1948, la démocratie même sous une forme limitée continuerait de fonctionner en Tchécoslovaquie. Il plaçait ses espoirs dans les élections qui devaient avoir lieu au printemps 1948 […]. Mais quand il a vu la Constitution et la loi électorale, il ne pouvait, en tant que démocrate convaincu, les accepter et il a abdiqué. »Il meurt quelques mois après son abdication, le 3 septembre 1948. Edvard Beneš part sur un échec politique : il n’a pas su préserver la démocratie en Tchécoslovaquie. Pour l’historien Igor Lukeš, cette défaite ultime à un moment stratégique explique en partie le legs contrasté d’un homme qui a pourtant tant fait pour son pays.