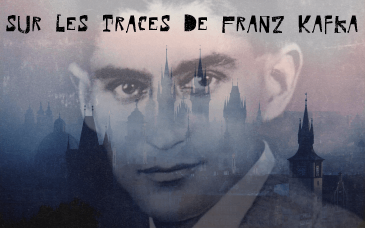« Tchéquie et Slovaquie sont divisées en zones ethnographiques, chaque folklore est assez différent »
La Française Zoé Perrenoud est musicienne et enseigne son art, installée dans la capitale tchèque depuis 2019.
Pouvez-vous vous présenter ?
« Je m’appelle Zoé Perrenoud, j’ai grandi dans le sud de la France, à côté de Perpignan. J’habite à Prague depuis presque six ans. Je suis d’abord venue ici en Erasmus, puis j’ai enchaîné avec un master et un mémoire. Je voulais ensuite me dédier à la musique. Je suis maintenant musicienne et professeur de musique, basée à Prague. »
Qu’est-ce qui vous a décidé de rester à Prague après votre Erasmus ?
« C’était surtout pour la musique, avec des rencontres et des groupes qui m’ont intégrée. Et puis, après l’Erasmus, c’était surtout le master auquel j’ai candidaté. J’ai reçu une bourse. C’était entre Budapest et Prague, et Prague était déjà pour moi un peu comme une maison. Un semestre se déroulait à Budapest, puis le reste à Prague. Je m’y sentais bien »
Dans quel master avez-vous étudié?
« Héritage culturel, master TEMA+. Je me suis spécialisée dans un aspect historique, un aspect ethnomusicologique et un aspect ethnologique. »
Vous êtes musicienne, accordéoniste. D’où vous vient cette passion ?
« Depuis petite. Mes parents ne sont pas musiciens. Mais dans la famille, mon papy est un violoniste de tradition orale, et ma tante est pianiste. Elle m’a appris à lire les notes. J’ai fait de la flûte à bec et du piano depuis petite. Mais je voulais faire de l’accordéon. Mes parents m’ont toujours soutenue dans ce choix. Je fais de l’accordéon depuis mes onze ans, et de la musique depuis mes six ans. »
Votre métier actuel est donc lié à votre pratique musicale.
« Oui, mais j’enseigne en parallèle. C’est un bon équilibre pour ne pas être juste dépendante des concerts, moins fréquents en hiver. Il faut être flexible, ce n’est pas très stable. L’enseignement, c’est ma stabilité et je souhaite que la musique reste une passion, que ce ne soit pas ma source principale de revenus. »
Par enseignement, vous entendez enseignement de la musique ?
« En école de musique, le piano et la flûte à bec. L’accordéon en cours individuels. J’enseigne à des groupes d’enfants à partir de 1 an et demi, 2 ans, jusqu’à 5 ans, disons plutôt en préscolaire. »
Vous avez mentionné que vous avez joué dans des groupes. Jouez-vous actuellement dans certains groupes ? Lesquels ?
« Il y en a plusieurs, qui sont surtout autour de la musique traditionnelle et de la musique du monde. Il y en a un de musique brésilienne, de forró, un de chansons françaises, un de bal folk, disons musiques traditionnelles françaises, et un de musique des Balkans. Il y a d’autres projets mais qui sont plus éphémères, ceux-ci sont mes projets stables. »
Comment avez-vous rencontré les personnes avec qui vous jouez dans ces groupes ?
« Soit au travers de lieux qui organisent des jam, soit au travers de concerts, soit par amis en commun, de bouche-à-oreille. Prague reste finalement une assez petite ville. J’ai oublié de mentionner, je suis aussi élève du conservatoire. J’ai rencontré beaucoup de musiciens là-bas. Quand j’ai terminé le master, j’ai tenté les examens d’entrée au conservatoire, et c’est maintenant ma troisième année. Le conservatoire m’a aussi permis de me dédier complétement à la musique, de m’imposer la discipline qui est nécessaire, de rencontrer pleins de gens, d’avoir l’espace nécessaire pour travailler. »
Vous avez dit que vous jouez de la musique du monde, de la musique traditionnelle, du forró, de la musique balkanique. Pourquoi s’être dédié à ce type de musique ?
« Tout simplement parce que ça me plaît ! Ensuite, ce sont les coïncidences du chemin, les gens que j’ai rencontré. J’ai toujours beaucoup aimé la musique balkanique, qui a des rythmes qui m’inspirent, qui me fascinent. Avec ces gens, qui sont aussi des amis, on aime la même musique, on a donc décider de s’y dédier ensemble. Pour le forró, ils cherchaient un accordéoniste. J’aimais bien et j’étais contente de découvrir avec eux ce monde-là. Pour moi, c’est tout un nouveau langage, mais j’aime bien. »
Il n'y a pas que le folklore morave dans le pays
Jouez-vous également de la musique traditionnelle tchèque ?
« Un petit peu. Par exemple, pendant les carnavals, les masopust, j’amène l’accordéon. Si je joue de la musique traditionnelle tchèque, ce n’est jamais dans un contexte de présentation, c’est toujours dans un contexte de célébration spontanée, où les gens vont chanter. »
Doit-on parler de musique traditionnelle tchèque au singulier ou au pluriel ?
« Au pluriel ! Mais c’est vrai que, surtout à Prague, quand on parle de musique traditionnelle, tout le monde s’imagine plus le folklore morave. C’est celui qui est le plus représenté. Mais je pense qu’il faut toujours en parler au pluriel. »
Pourquoi cette plus grande représentation du folklore morave ?
« Bonne question ! C’est le plus connu. C’est peut-être le plus mélodieux. C’est le plus joué. C’est celui qui a été le plus représenté. C’est celui qui est le plus vivant aujourd’hui. »
Quels sont les instruments typiques du folklore tchèque ?
« Il y a les cordes avec le cimbal ou cymbalum, la contrebasse, deux violons, un alto, un qui fera les contretemps. Cela serait le petit ensemble typique. Dans certaines régions, il y a d’autres instruments. Plus récemment, l’accordéon s’est rajouté, ainsi que la clarinette. Dans des formes encore plus modernes, on peut trouver des saxophones. Dans des formes presque éteintes, on retrouve la cornemuse, dans une région spécifique. »
Vous avez écrit votre mémoire sur la pratique traditionnelle à Prague. Comment cette pratique se caractérise ?
« Je me suis surtout intéressée, en m’inspirant de travaux intérieurs, aux mouvements participatifs. Il existe beaucoup de groupes folkloriques qui font des présentations sur scène, mais dans le cas de mon mémoire je me suis plus intéressé au côté spontané, pas forcément en costumes, de la musique. Il existe beaucoup de cercles où les gens vont se rencontrer pour chanter ensemble, pour danser ensemble. Le seul problème, c’est que j’ai écrit ma thèse au moment du covid, ce qui ne m’a pas permis de faire tous les travaux de terrain que je voulais. Ces cercles existent toujours, ils se rencontrent au moins une fois par mois, qui dansent, qui chantent, mais qui s’intéressent aussi à plein d’autres traditions. C’est très mélangé. »
Participez-vous à ces cercles ?
« Oui. Pas toujours en tant que musicienne, parfois seulement en tant que simple observatrice. La plupart des gens y participant sont devenus des amis. Donc oui, j’y participe. »
En tant qu’étrangère, l’intégration au sein de ces cercles a-t-elle été facile ?
« Peut-être que ça a mis quelque temps. Surtout qu’au début je ne parlais pas tchèque. Au moment de l’écriture du mémoire, un petit peu, de quoi poser les questions, de s’enregistrer et de travailler dessus. Mais pas au point d’avoir une conversation rapide et animée. Maintenant oui, donc je me crois aujourd’hui un petit peu plus intégrée. Ça s’est fait de fil en aiguille, assez facilement, au travers de la musique, qui est un langage universel. Le fait de partager cela a rendu l’intégration assez facile. »
Les cercles de musique traditionnelle d’ici se rapprochent beaucoup du bal folk
Pour faire une comparaison avec la France, ces cercles se rapprochent-ils de ce que l’on retrouve dans les bals folks, bals trads ou balèti ?
« Oui, je pense qu’il y a un grand parallèle. Même du côté de l’émergence de tous ces mouvements. Ici, ils étaient en réaction contre ce que le communisme avait établi, avait fait du folklore. C’était pour signifier qu’ils se réappropriaient le folklore, qu’ils vivaient à travers. »
Vous avez évoqué une dimension politique, que l’on retrouve également en France avec les bals folks, après mai 1968, quand les gens ont cherché à se réapproprier leurs racines. Ce serait donc la même chose ici ? Et pour suivre cette question, vous avez évoqué une image que le communisme a façonnée de ces traditions folkloriques, quelle est-elle ?
« Quelque chose de grandiose, sur scène, pour montrer l’unité, la grandeur de la nation. C’est contre cette image-là que ces mouvements participatifs sont nés. Le but n’est pas de jouer ou de performer pour un public, c’est de jouer pour soi, comme le bal folk. C’est pour le plaisir. Il y a une dimension sociale, avec pour objectif d’être ensemble, parce que l’on aime cela. Dans ces aspects, les cercles de musique traditionnelle d’ici se rapprochent beaucoup du bal folk. Il y a cependant plein d’ensembles folkloriques qui performent toujours sur scène en costumes de manière très chorégraphiée, qui ne laisse pas place à l’improvisation. Les deux aspects cohabitent. Les mouvements participatifs restent un petit cercle de gens, pas si connus du grand public. C’est une centaine de personnes qui se rencontrent régulièrement, qui creusent vraiment, qui s’y connaissent vraiment. Certaines personnes y participant ont grandi dans le folklore, avec des parents ou grands-parents leur ayant transmis ces pratiques. Il y a aussi des personnes qui ont approché le folklore dans un second temps, qui n’ont pas eu cette transmission au sein du cercle familial. Eux aussi effectuent beaucoup de recherches. La Tchéquie et la Slovaquie sont divisées en zones ethnographiques, chaque folklore est assez différent. »
Lesquelles ?
« Il y en a beaucoup. En Slovaquie, il y a une très belle région, Rejdová, avec un très beau folklore. Il est constitué de beaucoup de chants de femmes et d’harmonies qui me touchent beaucoup. »
Dans ces cercles que vous avez évoqués, quel type de musique y joue-t-on ? Va-t-on tenter de respecter une certaine authenticité, ou se permet-on des variations, des mix au niveau des influences ?
« La grande question de l’authenticité ! On va se permettre des variations, beaucoup de variations. C’est très libre, très lié, les frontières sont si difficiles à tracer. Il y a beaucoup d’influences différentes, qui s’étendent jusqu’aux Balkans, qui touchent à la musique des Klezmers. On ne se limite pas du tout dans l’authenticité de la musique traditionnelle tchèque. »
Avez-vous participé à une pratique plus scientifique de ce folklore, à celle d’un folkloriste, comme avec des collectages ?
« Non, à part quand j’ai écrit ce mémoire, avec les interviews que j’ai réalisées. J’ai interviewé des musiciens, de toutes générations. Certains étaient très âgés. Ils ont répondu à des questions sur la signification de leur pratique, sur les raisons de cette pratique, à quel point ils lient leur pratique à un côté national, social ou esthétique. C’est le seul collectage que j’ai réalisé. »
Pour revenir à ces cercles, si vous deviez dresser un portrait type des musiciens qui y jouent : origine, âge, sexe, pourquoi ils jouent de la musique. Quel serait-il ?
« Petite trentaine, très bons musiciens, beaucoup d’intérêts dans les traditions, les pratiques folkloriques. Beaucoup de recherches de leur côté. Des musiciens par contre très éclectiques. Certains se spécialisent quand même dans le folklore, mais d’autres sont plus éclectiques. Hommes, femmes, j’ai l’impression que c’est assez équilibré. »
Jouez-vous de la musique traditionnelle française, et si oui, quel accueil reçoit-elle ici ?
« Je m’y suis pas mal intéressée. J’ai un petit peu creusé dans les archives, surtout dans les archives de l’Occitanie, avec des danses comme les bourrées trois temps. Je n’en ai cependant pas trop joué ici. Peut-être quelques-unes pour les cercles de bal folk qui se rencontrent toutes les semaines et qui organisent des concerts où ils veulent de la musique live. Je suis sur leurs listes. L’accueil est très positif. »
Aviez-vous déjà une pratique plus orientée vers la musique traditionnelle en France ?
« Pas tellement, ou en tout cas pas vers le bal folk, la musique traditionnelle. J’ai dû venir ici pour creuser mes racines. Mais en France, je m’intéressais déjà à la musique des Balkans. A Toulouse, on avait un atelier, un orchestre de musique des Balkans. Et les musiques traditionnelles du monde entier m’ont toujours intéressé. La musique irlandaise aussi. J’ai découvert à Budapest cette façon de vivre le folklore. Finalement, c’est assez similaire aux bals folks. A Budapest, il y a les táncház, grâce auxquels tout le monde joue le folklore, le connaît vraiment. C’est ça qui m’a donné envie de creuser plus, de voir les parallèles, de chercher du côté français. »
Quel est le regard des tchèques sur le folklore ?
« Le folklore tchèque ou le folklore en général ? »
Les deux.
« Sur le folklore tchèque, quand ce n’est pas dans ces cercles, beaucoup de gens disent que c’est un petit peu mort, sauf en Moravie. C’est un peu vrai, mais il y a aussi beaucoup de festivals, de groupes, de mouvements dans la ville, de gens qui s’y intéressent. Il y a cette ambivalence de dire que d’un côté le folklore est mort et de l’autre que c’est très vivant. »
Furiant
On a beaucoup parlé de musique, mais que danse-t-on dans ces cercles ?
« Beaucoup de danses de couple, des furiant, les danses d’hommes, des soldats, des csárdás, avec des rythmes en um-dja-um-dja-um-dja, un peu comme une polka. Mais surtout des danses de couple ou des cercles de femmes et des danses d’hommes. »
Vous organisez un atelier de musiques françaises à l’institut Français le 29 mars, quelles musiques allez-vous présenter ?
« Ce n’est pas un atelier de musiques françaises, c’est un atelier de créations de chansons. C’est un atelier pour enfants, qui sera sur un thème, peut-être le printemps. Ce sera un grand échauffement vocal. Ça dépendra de qui viendra, de l’âge des participants et de ce qui va émerger. Je proposerai un thème, on fera un brainstorming sur ce thème, puis je proposerai des accords et on essayera d’inventer une mélodie ensemble. On a quarante-cinq minutes donc ce sera une petite chanson. »
On parlait de l’Institut français, de la France, quels sont vos liens avec la France aujourd’hui ?
« La France reste le pays de mon enfance, là où j’ai ma famille. Il m’a cependant toujours été un peu difficile de parler d’identité, parce que j’ai une maman irlandaise. Je ne me suis donc jamais senti complétement Française. Et puis j’ai un petit accent que tout le monde me fait remarquer. J’ai grandi dans un petit village, j’ai donc toujours eu envie d’explorer ailleurs, de partir à l’étranger. Après mon Erasmus, j’ai enchaîné sur d’autres projets qui ont fait que je suis resté ici. Je n’imaginais pas rester aussi longtemps. Mais je suis contente de pouvoir me dédier ici à la musique. Ça me fait cependant toujours chaud au cœur quand je retourne en France. J’aime les terrasses, j’aime les gens, leur ouverture, le soleil. Je viens du sud de la France aussi. Je m’imagine aussi peut-être y habiter. Mais la musique, ce sont des relations qui se construisent et ça fait presque 6 ans que je suis ici. En France, il me faudrait du temps pour retrouver avec qui jouer, et je pourrais être n’importe où en France, n’importe quelle ville ou n’importe quelle campagne. Je n’ai pas forcément de points d’attache à part là où est ma famille. Je sais que j’aurai toujours une très bonne relation avec ces paysages et ma famille. »
Vous comptez donc rester à Prague ?
« Pour l’instant oui. On verra combien de temps. »